Pour la reconnaissance du service médical rendu des cures thermales par la Haute Autorité de Santé : un enjeu pour la santé et pour nos territoires
Le thermalisme constitue un pilier historique de la médecine française, reconnu pour son efficacité dans le traitement et la prévention de nombreuses affections chroniques : rhumatologie, phlébologie, dermatologie, affections respiratoires, troubles anxieux ou métaboliques.
Chaque année, près de 500 000 curistes suivent une cure conventionnée, représentant à peine 0,13 % des dépenses de santé nationale, soit 350 millions d’euros pour 8,3 millions de journées de soins. [Source : Conseil National des Établissements Thermaux (CNETh)].
À titre de comparaison, l’Objectif national de dépenses de l’Assurance maladie (ONDAM) 2025 estime à 4,5 milliards d’euros le montant annuel de la fraude à l’Assurance maladie. Face à ces ordres de grandeur, le coût du remboursement des cures thermales apparaît dérisoire, d’autant qu’il s’agit d’un investissement utile et préventif, générateur d’économies à long terme pour la collectivité.
Pourtant, alors que les études scientifiques françaises et internationales démontrent aujourd’hui clairement les bénéfices médicaux, fonctionnels et psychologiques des cures thermales, leur service médical rendu (SMR) n’a jamais été officiellement évalué par la Haute Autorité de Santé (HAS). Cette absence de reconnaissance institutionnelle fragilise un dispositif pourtant exemplaire en matière de prévention, de qualité de vie et de maîtrise des coûts de santé.
Depuis 2004, l’Association Française pour la Recherche Thermale (AFRETh) a contribué à produire plus de 60 études cliniques, dont 35 publiées dans des revues scientifiques internationales, démontrant l’efficacité des cures pour plus de 90 % des indications médicales. Les résultats sont sans équivoque : baisse durable de la douleur, amélioration de la mobilité et de la qualité de vie, réduction de la consommation médicamenteuse, accompagnement post-cancer efficace…
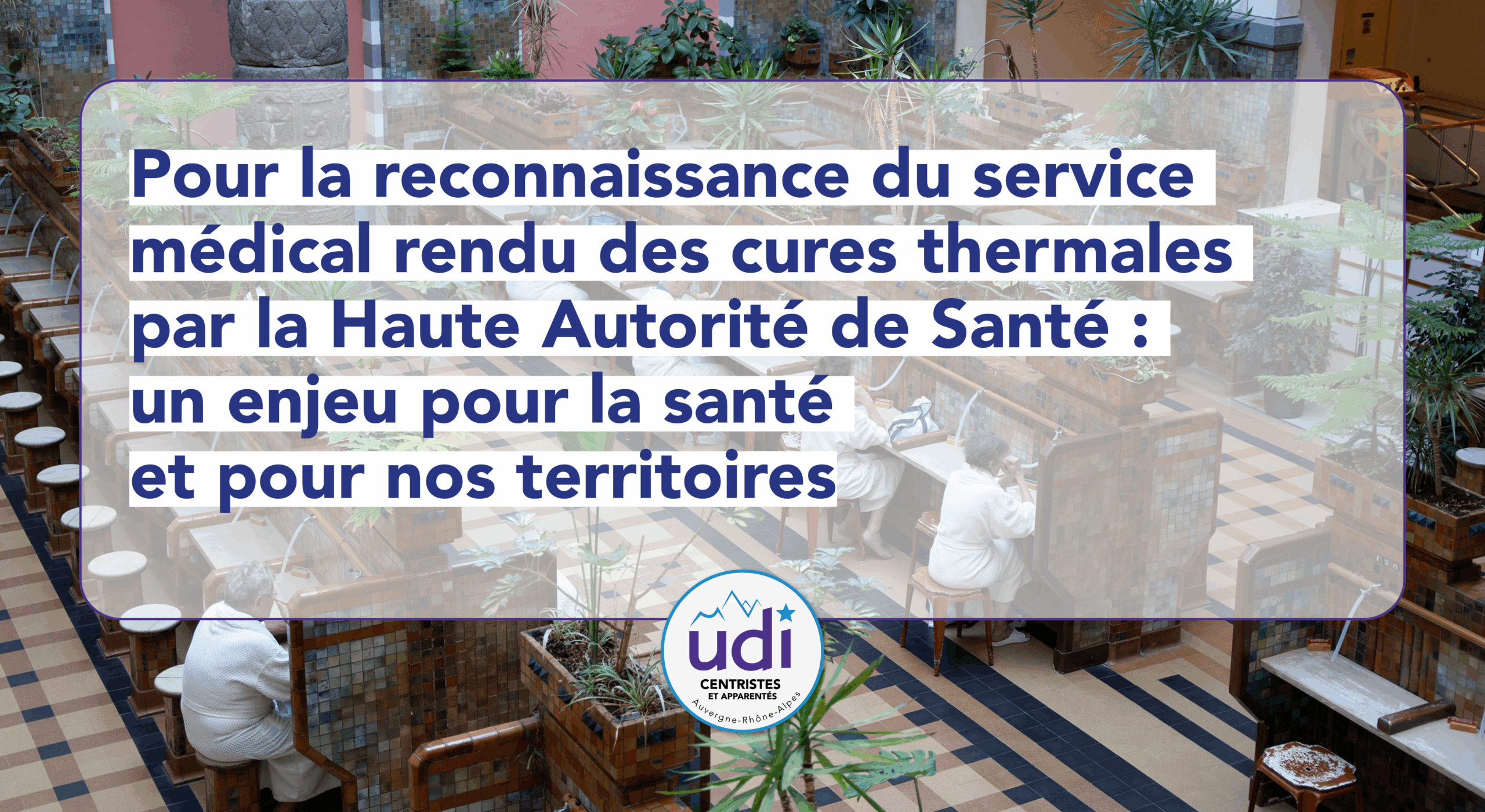
Un contexte national marqué par les contraintes financières

Dans un contexte de maîtrise renforcée des dépenses de santé et de révision de l’Objectif national de dépenses de l’Assurance maladie (ONDAM) 2025, la Cour des comptes, en avril 2025, a proposé de réévaluer la prise en charge des cures thermales, considérant que leur Service médical rendu (SMR) n’aurait pas été formellement établi par la Haute Autorité de Santé.
Le régime de remboursement des cures thermales est pourtant strictement encadré [Source : Service public] :
- La cure doit être prescrite par un médecin et réalisée dans un établissement agréé et conventionné ;
- La durée minimale de18 jours de soins effectifs est obligatoire pour ouvrir droit à remboursement ;
- Lessoins thermaux (forfait thermal) sont remboursés à 65 % du tarif conventionnel, et les honoraires médicaux à 70 % ;
- Lesfrais d’hébergement peuvent être pris en charge à 65 % sur la base d’un forfait de 150,01 €, soit une participation de 97,50 €, et les frais de transport à 55 %, sur la base du tarif SNCF 2ᵉ classe aller-retour, sous conditions de ressources.
En réalité, moins de 15 % des curistes bénéficient de ces aides complémentaires et le reste à charge moyen demeure élevé, autour de 800 à 1 000 € par cure. Ainsi, loin de constituer une dépense excessive, la prise en charge actuelle des cures thermales s’inscrit dans un cadre rigoureux, maîtrisé et socialement ciblé. [Source : Conseil National des Établissements Thermaux (CNETh)].
Dans ce contexte, réduire ou supprimer le remboursement des cures thermales reviendrait à fragiliser une médecine préventive naturelle, sans effets secondaires, qui participe à la réduction des prescriptions médicamenteuses, à la prévention des hospitalisations et au maintien de l’autonomie des patients.
Une telle évolution aurait des conséquences directes sur l’accès aux soins pour des patients souvent modestes et sur l’équilibre économique d’un secteur essentiel à la vitalité et à l’emploi dans de nombreux territoires ruraux et de montagne.
Il apparaît donc indispensable que la Haute Autorité de Santé se saisisse du sujet afin d’éclairer objectivement la décision publique, en évaluant scientifiquement le service médical rendu des cures thermales et les perspectives offertes par les formats de cures plus courtes, moins coûteuses et plus adaptées aux modes de vie actuels.
Vers une meilleure reconnaissance des cures thermales de courte durée
Au-delà de la reconnaissance du service médical rendu des cures conventionnées de 18 jours, il apparaît également nécessaire d’étudier scientifiquement l’efficacité des cures thermales de plus courte durée, aujourd’hui non remboursées par la Sécurité sociale.
Ces formats de 6 à 12 jours, déjà proposés par plusieurs établissements thermaux, répondent à une évolution des modes de vie : ils sont mieux adaptés aux actifs, aux aidants ou aux personnes ne pouvant s’absenter trois semaines de leur domicile ou de leur emploi. Ils pourraient ainsi élargir l’accès au thermalisme à de nouveaux publics, tout en réduisant le coût global pour l’Assurance maladie.
Les comparaisons européennes montrent que ces formats courts sont déjà reconnus et pris en charge dans plusieurs pays : 12 jours en Italie et en Espagne, 6 à 15 jours en Hongrie, jusqu’à 18 jours en Lituanie. Dans ces États, les résultats observés en matière de prévention et de bien-être sont jugés significatifs, tout en représentant une charge financière modérée pour les régimes d’assurance maladie. [Source : European SPAS association]
Lancer une évaluation scientifique des mini-cures permettrait à la Haute Autorité de Santé de mesurer leur service médical rendu, d’en objectiver les bénéfices cliniques et économiques, et, le cas échéant, de proposer une évolution du cadre de remboursement adaptée à ces nouveaux formats. Cette approche équilibrée offrirait une voie pragmatique : préserver le thermalisme dans le cadre d’une politique de santé publique plus soucieuse de prévention, d’efficience économique et d’égalité d’accès aux soins.

Un enjeu fort pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Avec 23 stations thermales réparties dans 10 départements, Auvergne-Rhône-Alpes est la troisième région thermale de France.
De Vichy à Aix-les-Bains, en passant par Thonon-les-Bains, Saint-Gervais-Mont-Blanc, La Léchère, Châtel-Guyon, Le Mont-Dore ou Vals-les-Bains, le thermalisme régional constitue un véritable pilier de santé publique, d’attractivité et de développement local.
Il représente :
- Près de 100 000 curistes par an pour les cures conventionnées,
- 1,74 millions de journées curistes conventionnées de 18 jours,
- Plusieurs milliers d’emplois directs et indirects,
- Et un apport économique majeur pour des territoires ruraux et de montagne.
Selon l’Observatoire national de l’économie des stations thermales (OESTh 2024), le thermalisme régional génère 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 6 526 équivalents temps plein (ETP) directs, indirects et induits.
Les entités thermales versent 32 millions d’euros de taxes locales et de contributions à l’État (sur un total national de 72 M€).
Par ailleurs, 54 % des dépenses des établissements sont réalisées auprès de sous-traitants locaux et régionaux, confirmant le rôle structurant du thermalisme dans l’économie de proximité.
Les stations thermales participent ainsi pleinement à la politique régionale de santé, de bien-vieillir, de l’attractivité touristique et de revitalisation des territoires, en alliant médecine préventive, économie locale et valorisation du patrimoine hydrominéral de la région.
Les établissements régionaux se sont par ailleurs fortement engagés dans la recherche clinique, la modernisation des infrastructures et la diversification de l’offre, notamment à travers le développement de cures de courte durée, adaptées aux rythmes de vie actuels.